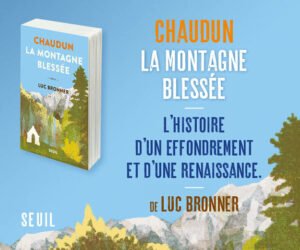La laïcité n’est pas une idéologie au service d’un camp
Le principe de laïcité est le prétexte de multiples débats, parfois vifs, sur sa définition elle-même, mais aussi parce qu’il cristallise le rapport de la société à la religion et à son expression. Bien que beaucoup s’en défendent, sont ainsi parfois évoquées par certains prescripteurs d’opinion des laïcités qui peuvent être qualifiées d’« antireligieuses », de « gallicanes », de plus ou moins « séparatistes », d’« ouvertes », d’« accommodantes », de « fermées », ou encore d’« identitaires ». De fait, depuis son origine, différentes conceptions intellectuelles de la laïcité s’opposent et conduisent à une confusion sur le sens et la portée de ce terme.
Intellectuellement, chacun a toujours tendance à identifier sa propre vision subjective de la laïcité à ce qu’elle devrait être dans l’absolu. Mais le cadre juridico-politique laïque français, défini par nos textes fondateurs et par la loi du 9 décembre 1905 en particulier, ne peut pas connaître une application à géométrie variable selon les circonstances et les convictions des uns et des autres. En ce sens, il n’y a qu’une seule laïcité et l’adjectiver ne ferait qu’en minorer la portée.
La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l’ordre public. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir. La laïcité garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses et les moquer est parfaitement possible pour quiconque.
La laïcité implique la séparation de l’État et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’État –